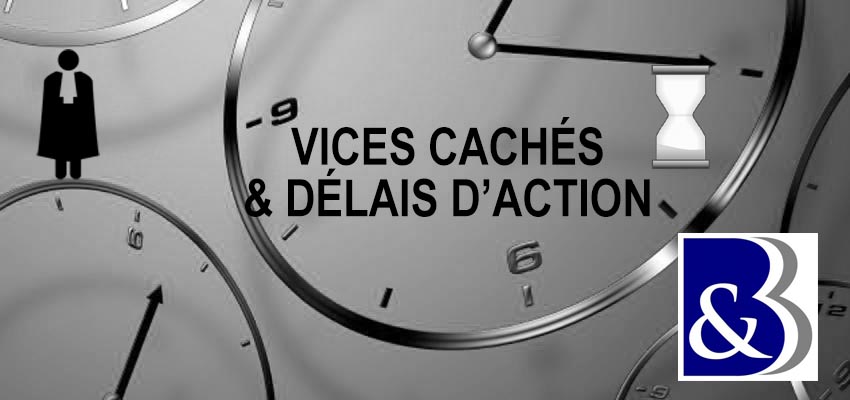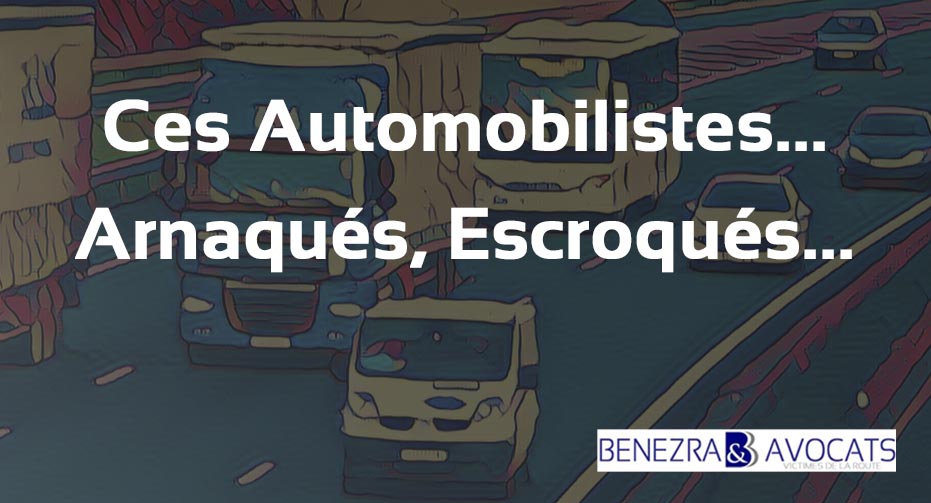Un nouveau régime de l’action en garantie des vices cachés fixe désormais la prescription de l’action à 5 ans au plus (régime de droit commun) mais, la réduit à 2 ans, à compter de la découverte du vice caché (régime de droit spécial).
La prescription en matière de garantie des vices cachés est traditionnellement évoquée avec un délai de 2 années (anciennement action à à bref délai).
C’est l’article 1648 du code civil qui dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Néanmoins, ce délai de 2 années, reste encadré, dans une action engagée dans les cinq ans de la vente.
En gros, si vous découvrez un vice caché, 4 ans après la vente, il vous reste 1 an pour agir, mais si vous découvrez le vice 5 ans ou plus, après la vente, le délai des 2 ans ne sera plus applicable car vous serez prescrit à agir.
Autrefois, le délai qui encadrait le tout était fixé à 10 ans si la vente était intervenue entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
Désormais, L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, mais également l’être dans les cinq ans de la vente.
Que faut-il retenir en matière de délais d’action avant d’engager une action en garantie des vices cachés ?
- que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les cinq ans de la vente pour les véhicules qui ont été vendus
- que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans toutefois dépasser le délai des cinq ans
Le cabinet BENEZRA AVOCATS intervenant en droit automobile a vu ces derniers temps, accroître le nombre de contentieux dans ce domaine des vices cachés. Nous ne pouvons que vous recommander la plus grande vigilance alors lorsque vous contractez dans le domaine…
N’hésitez pas à consulter le cabinet, en charge de plusieurs dossiers de ce type, et ce sans engagement de votre part.
Maître Michel BENEZRA, avocat automobile
Tel : 01.45.24.00.40